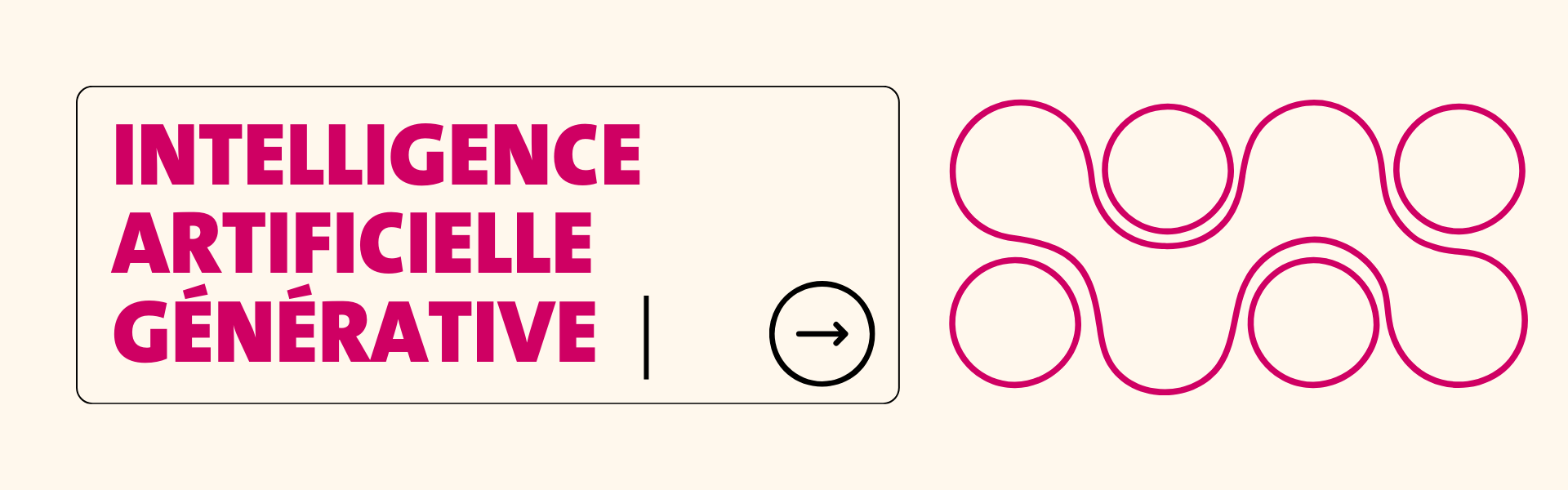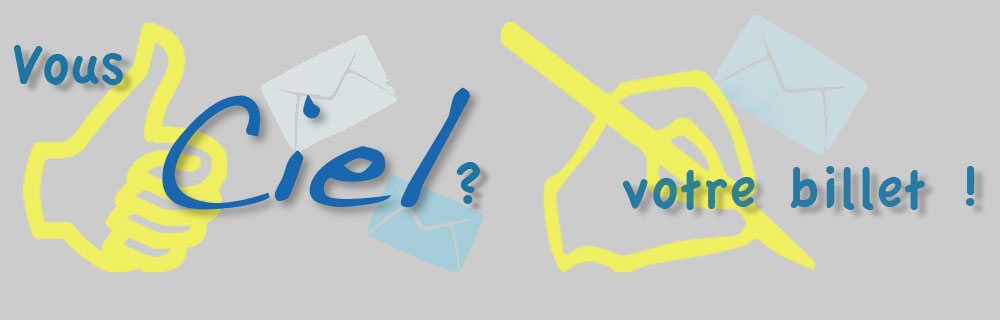La réalité virtuelle et augmentée pour l’apprentissage
Un peu d’histoire
L’apparition de la réalité virtuelle remonte aux années 1960-1970. L’intérêt de la réalité virtuelle dans le secteur de l’éducation et de la formation n’est plus à démontrer. Permettre à des apprenant∙e∙s de s’entraîner pour différentes activités : piloter un avion ou tout autre type de véhicule, réaliser une opération chirurgicale ou explorer notre système solaire. Un des intérêts de la réalité virtuelle dans le domaine de la formation est de permettre d’immerger l’apprenant∙e dans un environnement virtuel qui soit suffisamment crédible et réaliste pour lui permettre de s’entraîner dans des conditions suffisamment proches du réel. Ces conditions sont particulièrement intéressantes pour des activités pour lesquelles un environnement d’entraînement réel serait trop coûteux ou trop dangereux. La réalité virtuelle est beaucoup utilisé pour l’entraînement des pilotes (civils ou militaires). Il est moins grave et couteux de crasher un avion sur un simulateur plutôt qu’un « vrai ».