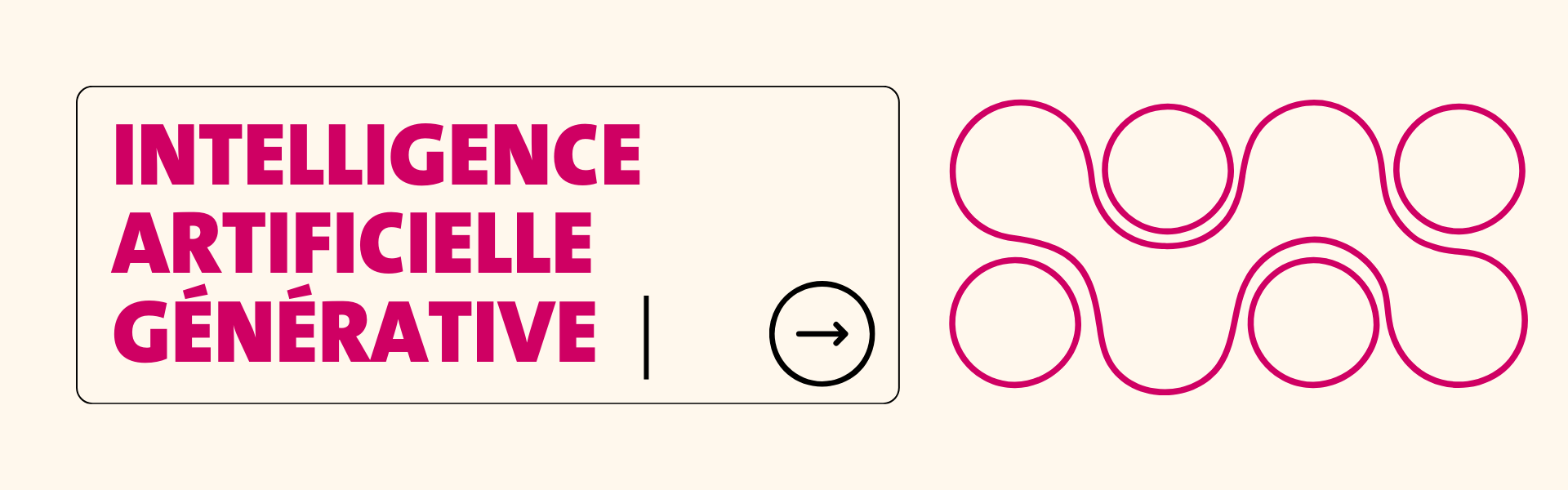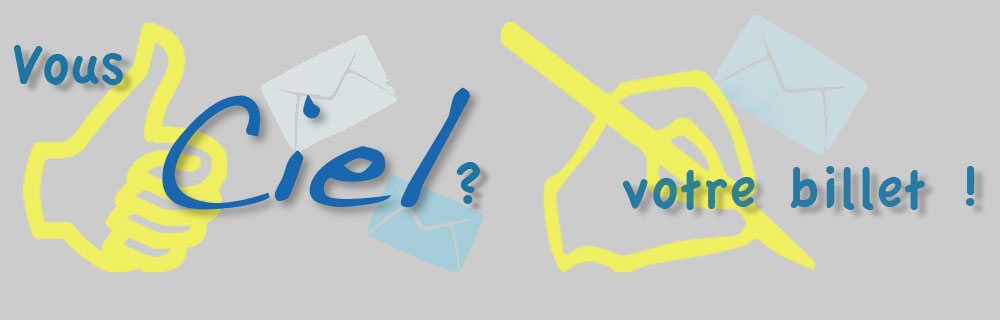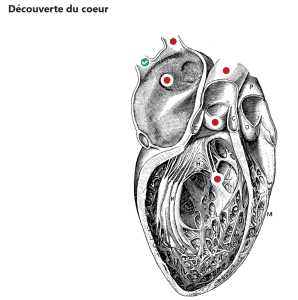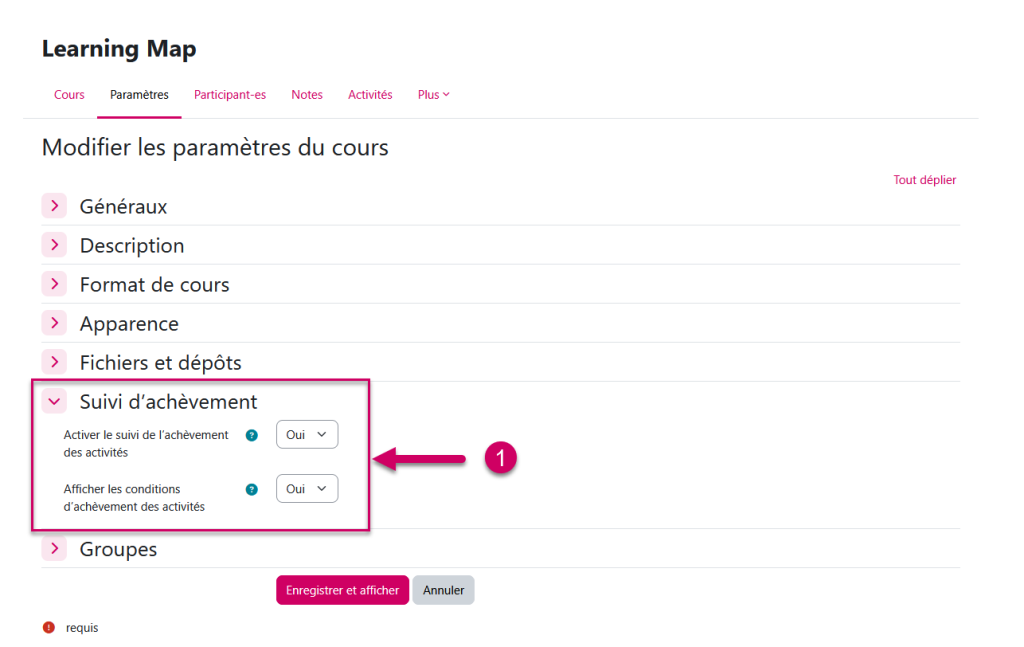IA et enseignement : les ressources indispensables !
L’IA, c’est LE sujet d’actualité dans les hautes écoles et universités. Impossible de passer à côté quand on enseigne puisque les étudiantes et étudiants l’utilisent régulièrement. Cependant, il est difficile de tout lire et de rester à jour sur le sujet de manière pertinente. C’est pourquoi nous vous proposons une sélection de ressources soigneusement choisies par l’Université de Neuchâtel.
Un Padlet de ressources
Elaboré en collaboration entre l’UNIGE, l’UNIL et l’UNINE dans le cadre d’un projet soutenu par swissuniversities, ce mur collaboratif propose une sélection de documents et de sources pour guider les enseignantes et enseignants universitaires dans leurs réflexions sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans leurs pratiques pédagogiques.
Organisé en cinq sections, il offre un panorama structuré permettant de comprendre le fonctionnement de l’IA, d’explorer son utilisation dans les cours, de repenser l’évaluation des connaissances et des apprentissages, d’aborder les questions d’intégrité scientifique, et de communiquer avec les étudiantes et étudiants sur l’IA. Le nombre limité de publications favorise une lecture claire et rapide. Le contenu est appelé à évoluer régulièrement grâce à des mises à jour qui intègrent les nouvelles pratiques et les retours de la communauté académique. Le mur est disponible en anglais, avec des ressources en anglais et en français et nous travaillons à une version en français.
Des ressources à l'UNIGE
Vous retrouvez toutes les ressources internes à l’UNIGE sur le portail de l’enseignement et notamment celles abordées dans le dernier lunch pédagogique IA et enseignement à l’UNIGE : regards et expériences d’enseignantes et d’enseignants.
Un BarCamp sur le thème

Bannière créée par Noémie Chappuis
Á vos agendas : notez déjà la date du prochain BarCamp Ciel qui abordera spécifiquement la thématique de l’intelligence artificielle dans le cadre de l’enseignement. Cet événement vous permettra de découvrir ce que vos collègues de différentes facultés ont mis en place pour leur enseignement et d’échanger directement avec elles et eux sur leur pratique. Vous pourrez poser vos questions, vous inspirer d’exemples concrets, découvrir de nouvelles ressources, tout en profitant d’un apéritif durant l’événement.
jeudi 18 décembre | 12h-14h
Agora Uni Mail
Journée romande IA et enseignement
Toujours dans le cadre du projet soutenu par swissuniversities, l’UNIGE proposera une journée dédiée à l’IA et l’enseignement intitulée “Quand l’IA bouscule les auditoires – Regards croisés sur l’enseignement supérieur”.
Cette journée interinstitutionnelle proposera conférences, témoignages, ateliers pratiques et tables rondes consacrés à l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur.
Save the date également pour cette journée gratuite et sur inscription:
19 mars 2026
Campus Biotech
De plus ample seront indiquées sur un site web dédié qui sera accessible en décembre 2025