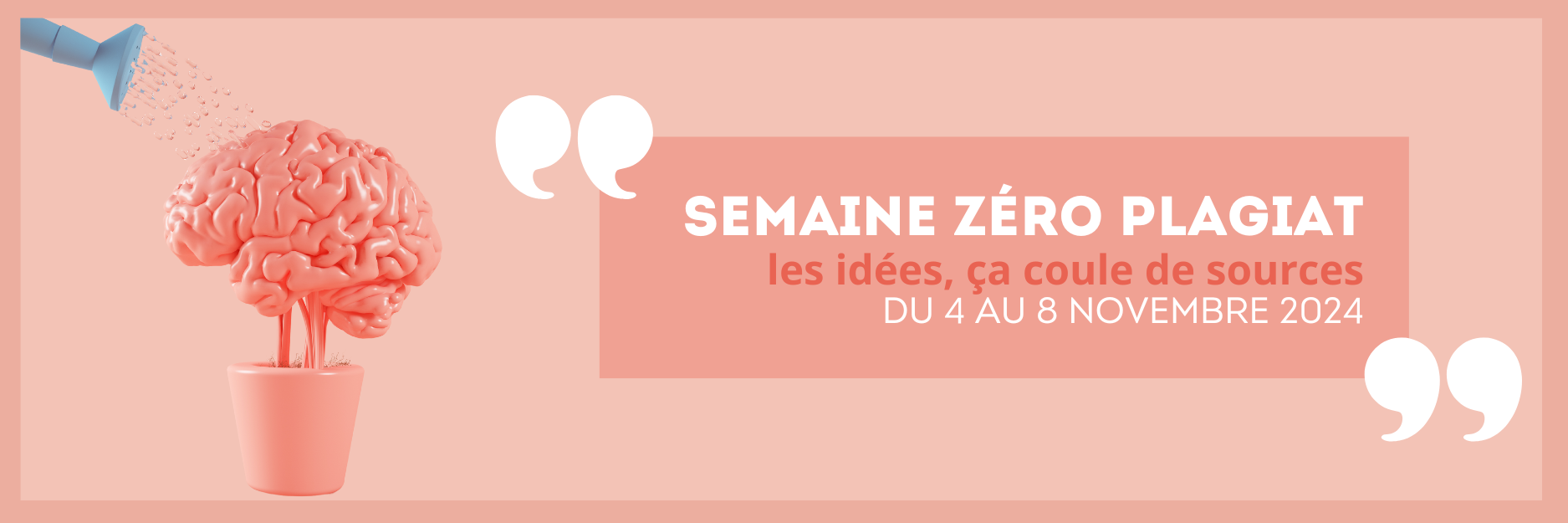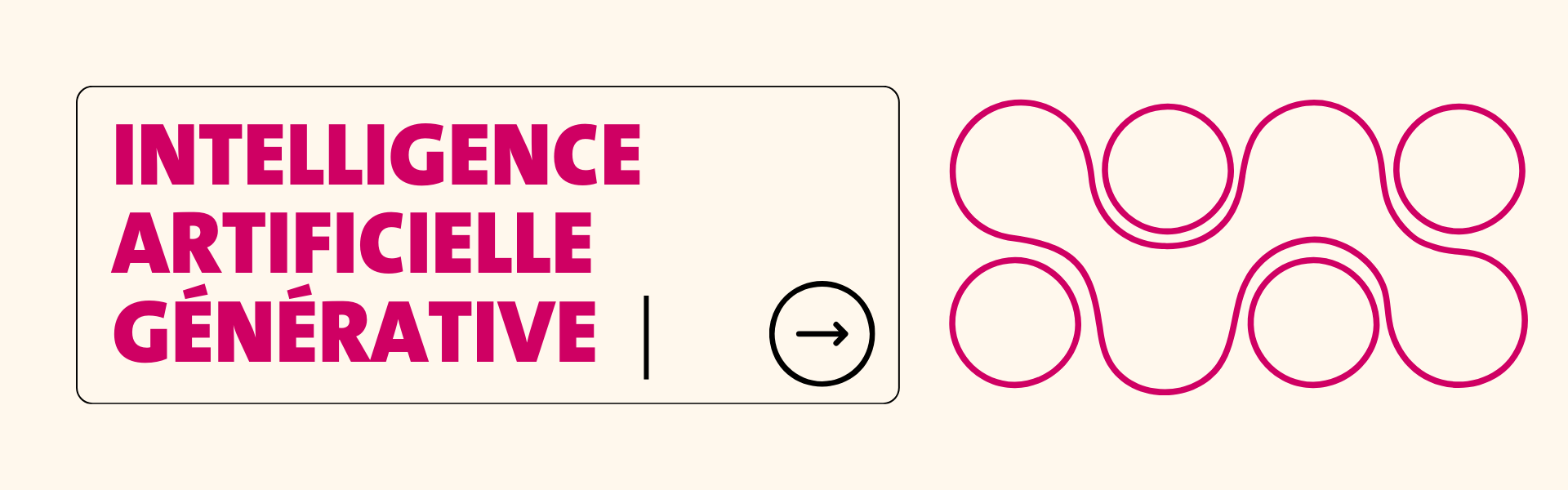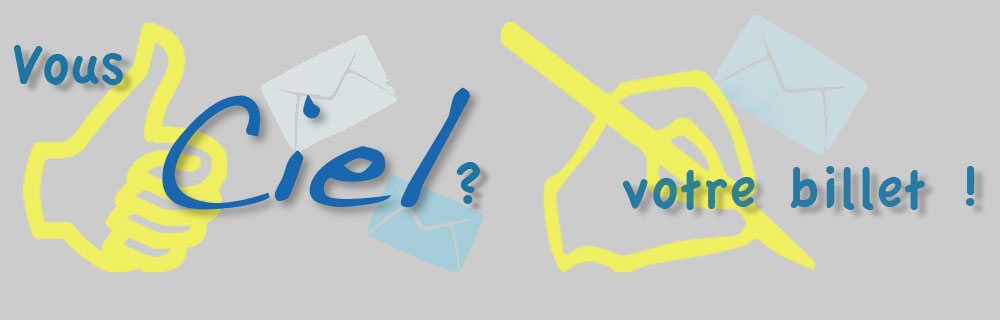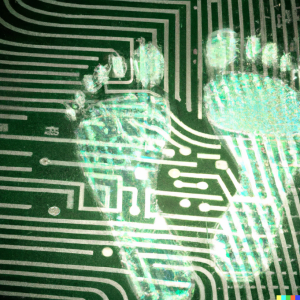Les jeux, sérieux?
Ce billet de blog vous est présenté par Noémie Chappuis (Pôle elearning) et Aviva Sugar Chmiel (UDREM)

Apprendre par le jeu n’est pas une nouveauté dans l’histoire de l’humanité. Depuis toujours et dès l’enfance, le développement de qualités physiques, intellectuelles et sociales, de l’adresse ou de l’habileté s’est fait par le jeu et ce format est aujourd’hui largement répandu, par exemple dans les entreprises. La notion de plaisir est généralement associée à ces apprentissages et c’est là toute leur valeur. Il s’agit bien de plaisir et non d’amusement, une distinction importante lors des débats sur l’utilisation du jeu dans un contexte d’enseignement, ce qu’on appelle aujourd’hui « jeu sérieux ». (Prensky 2001).
Cette approche présente l’avantage de permettre la mobilisation et l’application des connaissances théoriques à des situations inspirées de la réalité tout en apportant une motivation d’apprentissage marquée.
Les jeux sérieux sont par essence centrés sur l’apprenant-e puisque c’est elle/lui qui « mène le jeu » (Deci and Ryan 2000, Garris, Ahlers et al. 2002). La motivation est intrinsèque et renforcée par la perspective d’être récompensé d’une manière ou d’une autre pour un progrès ou un avancement dans ses compétences.
Est-ce que le jeu sérieux améliore l’apprentissage? Comme pour beaucoup d’interventions dans le domaine pédagogique, le choix de la méthode appropriée pour évaluer le succès lors de l’utilisation de jeux sérieux ainsi qu’une évaluation rigoureuse de l’intervention sont indispensables pour développer des connaissances basées sur des preuves (Haoran, Bazakidi et al. 2019, van Gaalen, Brouwer et al. 2021).
Le développement des jeux en ligne, des outils numériques et plus récemment des jeux d’évasion a ouvert encore plus le champ des possibilités pour l’utilisation du jeu dans l’enseignement et l’apprentissage, une évolution qui se traduit par une augmentation exponentielle des publications dans ces domaines (Fotaris and Mastoras 2019, Haoran, Bazakidi et al. 2019)
Définitions - du jeu sur table au jeu d'évasion
Selon le dictionnaire Larousse, le jeu est une « Activité de loisir soumise à des règles conventionnelles, comportant gagnant(s) et perdant(s) et où interviennent, de façon variable, les qualités physiques ou intellectuelles, l’adresse, l’habileté et le hasard. ».
Jeu sérieux :
Activité d’apprentissage autodirigée, permettant d’acquérir des compétences en étant actif dans un environnement fictif, et comportant un élément de récompense et/ou de plaisir (Ricciardi and De Paolis 2014, PELLON, RAUCENT et al. 2020). Les compétences acquises peuvent être très techniques, mais également former à la collaboration et au travail d’équipe.
Jeu de rôle :
Un jeu de rôle est une technique ou activité, par laquelle une personne interprète le rôle d’un personnage (réel ou imaginaire) dans un environnement fictif. Le jeu de rôle peut être notamment une technique thérapeutique (psychologie), une méthode pédagogique, une méthode d’analyse ou bien une activité récréative. […] Quand l’anglais diffère le jeu d’interprétation (role-playing) de l’activité ludique (role-playing game), le français ne fait pas la différence à cause de la suppression de la redondance du terme « jeu ».1
Simulation :
Activité permettant d’exercer des compétences dans un environnement sécurisé reproduisant une réalité existante (Ricciardi and De Paolis 2014).
Serious escape game ou jeux d’évasion pédagogique :
Un serious escape game (SEG) est une formule pédagogique qui plonge les apprenant-es dans une situation – problème à résoudre collaborativement dans un temps limité. L’enseignant-e s’appuie sur l’expérience de jeu pour faire le lien avec les objectifs disciplinaires. (Pascal Vangrunderbeek et Isabelle Motte, UCLouvain-LLL**)
1https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_r%C3%B4le 7.10.22
Qu’est-ce qui fait qu’un jeu est un jeu ?
Bedwell et al. ont identifié neuf catégories d’attributs du jeu, mutuellement exclusives, qui permettent un regard différencié sur le jeu sérieux (Bedwell, Pavlas et al. 2012):
| Attribut | Définition | Exemples |
| 1. Langage d’action | Langage ou outils utilisés par les joueurs/joueuses pour exprimer leur intention | Textes à taper, manipulation d’objets (pion, outils), glissement de doigts, manchettes de commandes (Joystick) |
| 2. Evaluation | Mode d’évaluation du progrès des joueurs | Monitoring du progrès en continu, atteinte d’étapes, accès à des informations ou « pouvoirs » permettant de progresser, obtention de points |
| 3. Types de défi | Conflit, concurrence, défi, surprise, adaptation | Jeu centré sur la concurrence ou la collaboration, jeu centré sur le progrès dans le niveau, adaptation du scénario selon la performance, degré d’incertitude dans le jeu |
| 4. Manipulation | Eléments manipulés pendant le jeu et degré de contrôle sur le déroulement | Manipulation directe d’objets physiques ou d’outils faisant partie du jeu, interaction avec des éléments virtuels ou des concepts, degré de contrôle sur les éléments du jeu |
| 5. Environnement | Contexte dans lequel le jeu se déroule | Monde virtuel, reproduction d’un contexte existant (par exemple chambre d’hôpital), positionnement des joueurs/joueuses dans l’environnement (par exemple vision en « première personne ») |
| 6. Fiction | Degré de fantaisie, mystère | Pouvoirs, outils ou dimensions n’existant pas dans la réalité, éléments métaphoriques, mystère (différence entre éléments connus et inconnus, complexité de l’information) |
| 7. Interactions humaines | Jeu individuel, jeu en ligne avec de multiples partenaires de jeu, jeu en groupes | Jeu solo, Jeu multijoueurs1, avec ou sans maître/esse de jeu ou superviseur/euse, avec ou sans outil de communication entre joueurs |
| 8. Immersion | Eléments favorisant une immersion dans le jeu, perception du jeu par les joueurs/joueuses | Eléments haptiques (toucher, vibrations), visuels (films, graphisme), auditifs (signaux sonores, musique), émotionnels, sentiment d’abrogation des règles de la réalité et donc d’absence de conséquences réelles. |
| 9. Règles et buts | Communication des consignes, des objectifs à atteindre, des règles en vigueur dans le jeu | Informations ou non sur les étapes à atteindre, les conditions pour terminer l’étape ou le jeu, les actions possibles ou impossibles/interdites, le temps restant |
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Multijoueur
Les profils des joueurs et joueuses
Il est incontestable que le jeu sérieux peut être un outil d’apprentissage très puissant à condition qu’on prenne en compte la personne qui en est le centre : le joueur ou la joueuse. Il paraît logique que l’expérience préalable avec des jeux en ligne, par exemple, va influencer l’acceptation et le temps de familiarisation avec un jeu sérieux numérique.
Pour bien ludifier, il faut comprendre que tout le monde ne joue pas de la même manière et surtout ne veut pas jouer tout le temps ».(PELLON, RAUCENT et al. 2020). Plusieurs études (i.e. Bartle, 1990, 1996 ; Yee, 2006) ont mis en évidence quatre grands profils de joueurs et joueuses :
- Le profil « conflit » préférant jouer contre ou en compétition avec les autres
- Le profil « stratégie » préférant prendre des décisions et planifier des actions
- Le profil « immersion » préférant être plongé-e dans un monde alternatif crédible avec des possibilités de choisir et customiser son personnage.
- Le profil « amusement social » privilégiant des jeux permettant avant tout de passer un bon moment convivial avec d’autres personnes, de coopérer.
Un jeu conçu en prenant en compte l’utilisateur/trice final-e et en définissant soigneusement les attributs du jeu aura donc des chances d’entraîner les étudiant-e-s dans une spirale motivationnelle positive où ils/elles auront du plaisir à apprendre.
Conception d'un jeu sérieux
Dans leur publication du Louvain Learning Lab « Jouer pour apprendre dans l’enseignement supérieur », l’équipe de Gaëlle Pellon offre entre autres un guide pratique pour la mise en place d’un dispositif d’apprentissage ludifié. Ils visualisent une séquence d’apprentissage dans le schéma ci-dessous :
Une séquence type d’un dispositif d’apprentissage ludifié (PELLON, RAUCENT et al. 2020)
Quelques exemples d'ici et d'ailleurs
Les jeux sérieux investissent différents domaines tels que la formation dans les sciences de la santé, les entreprises, ainsi que le milieu scolaire et universitaire. Les deux autrices ont eu la chance de vivre des expériences enrichissantes avec ces jeux au cours de leurs carrières.
Expériences vécues
Santé au travail
Prenons par exemple une session de formation sur la santé au travail qu’une des autrices a vécu. Plongés dans une simulation d’accident survenu dans un environnement professionnel, des petits groupes ont été créés et ils avaient pour mission de décrypter le mystère entourant l’événement. Quelle en était la cause ? Quels facteurs ont contribué à cet accident ? Comment s’est-il produit ? En explorant minutieusement la scène, chaque groupe devait répondre à ces questions. À la fin du temps imparti, une séance de debriefing a permis de partager les découvertes et les enseignements tirés de cette expérience immersive.
Machines de diagnostic
Un autre exemple fut la création, avec des collègues, d’un jeu de société visant à former des techniciens-techniciennes spécialisé-ées dans la réparation de machines de diagnostic. Ce jeu de plateau comportait des étapes clés pour effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement de la machine. Pour progresser dans le jeu, les joueurs et joueuses devaient lancer des dés. Selon les cases atteintes, des cartes proposaient des handicaps (« La pièce de rechange est indisponible, rendez-vous au centre de réparation, reculez d’une case ») ou des avantages (« La pièce de rechange est arrivée plus tôt que prévu, avancez de deux cases supplémentaires »).
L’objectif était de familiariser les équipes de techniciens-techniciennes avec une grande diversité de scénarios et situations qu’elles-ils pourraient rencontrer dans leur quotidien professionnel. Ce jeu présentait aussi l’avantage d’être utilisé dans des régions reculées où l’accès à internet est limité, offrant ainsi une alternative aux formations en ligne.
À chaque occasion, les jeux sérieux suscitaient une motivation bien plus marquée chez les participant-es que les méthodes traditionnelles de formation, comme les présentations formelles dispensées par un-e formateur/trice.
Laissez-vous surprendre!
Les jeux sérieux se déploient dans des contextes variés, parfois sans même que l’on s’en rende compte.
- https://education.minecraft.net/fr-fr
- https://coronaquest.game/
- https://www.flightsimulator.com/
- Go Nisha Go
Ces exemples illustrent la diversité et la portée des jeux sérieux pour apprendre et se former dans des domaines variés.
Et chez nous?
À l’UNIGE, le jeu sérieux intéresse et inspire : Quelques projets sur la page d’innovation de l’UniGE:
Rédaction scientifique: https://www.unige.ch/innovations-pedagogiques/project-list/la-course-la-citation
Management de projet: https://www.unige.ch/innovations-pedagogiques/project-list/simulations-en-jeu-serieux
Projet d’urbanisme: https://www.unige.ch/innovations-pedagogiques/project-list/jeu-serieux-projet-authentique
Escape sur le thème de l’Open access: https://www.unige.ch/innovations-pedagogiques/project-list/escape-the-lab
Illustration: environnement de jeu de l’escape sur table « Escape the lab »
On réalise que les jeux sérieux sont variés et peuvent intégrer une multitude de supports et de formats. Les objectifs d’apprentissage sont également divers, mais ils visent toujours un apprentissage spécifique et ciblé.
Conclusions
Ce tour d’horizon nous a permis de définir ce qu’est un « jeu sérieux » et quels éléments le composent. Plus que pour une autre intervention pédagogique, le profil des étudiant-es va jouer un rôle central et doit être pris en compte si on veut qu’ils/elles « entrent dans le jeu » et aient du plaisir tout en apprenant. C’est là le levier principal pour que l’effet motivant du jeu puisse prendre place.
La conception pédagogique argumentée et l’évaluation rigoureuse de cette activité d’apprentissage sont incontournables.
Références
Bedwell, W. L., et al. (2012). « Toward a taxonomy linking game attributes to learning: An empirical study. » Simulation & Gaming 43(6): 729-760.
Deci, E. L. and R. M. Ryan (2000). « The » what » and » why » of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. » Psychological inquiry 11(4): 227-268.
Fotaris, P. and T. Mastoras (2019). Escape rooms for learning: A systematic review. Proceedings of the European Conference on Games Based Learning.
Garris, R., et al. (2002). « Games, Motivation, and Learning: A Research and Practice Model. » Simulation and Gaming 33(4): 441-467.
Haoran, G., et al. (2019). « Serious games in health professions education: review of trends and learning efficacy. » Yearbook of medical informatics 28(01): 240-248.
IJgosse, W., et al. (2020). « Construct validity of a serious game for laparoscopic skills training: validation study. » JMIR serious games 8(2): e17222.
PELLON, G., et al. (2020). Les cahiers du LLL–N° 8: Jouer pour apprendre dans l’enseignement supérieur?, LLL, Presses universitaires de Louvain.
Prensky, M. (2001). « Fun, play and games: What makes games engaging. » Digital game-based learning 5(1): 5-31.
Ricciardi, F. and L. T. De Paolis (2014). « A comprehensive review of serious games in health professions. » International Journal of Computer Games Technology 2014.
van Gaalen, A. E., et al. (2021). « Gamification of health professions education: a systematic review. » Advances in Health Sciences Education 26(2): 683-711.
Vion, M., et al. (2020). « Jeu d’évasion (escape game) médicamenteux: un apprentissage ludique et coopératif. » Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien 55(2): 136-142.