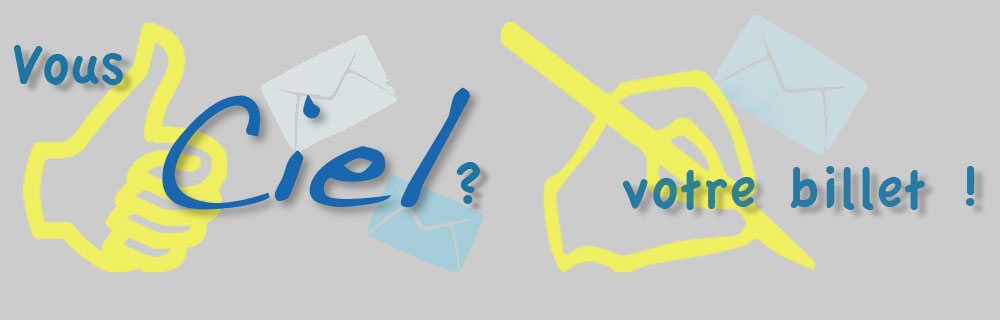Le point aveugle
Dans ce billet, une fois n’est pas coutume, nous parlerons d’écologie. La rencontre du CIEL avec la Terre, en quelque sorte.
Il peut sembler quelque peu déplacé d’aborder ce thème au milieu d’articles sur le numérique et ses usages pour l’enseignement et l’apprentissage. D’ailleurs, parlant d’écologie, le numérique n’est-il pas ce lieu dématérialisé, supprimant avantageusement l’usage massif du papier (donc l’abattage d’arbres), abolissant les distances (et donc les transports matériels), nous unissant tous dans un monde éthéré (le cloud), où, en quelques clics discrets, sur des terminaux toujours plus légers, nous pouvons exercer nos activités de plus en plus virtualisées, s’affranchissant des lourdes (et polluantes) contraintes du monde matériel ? Qui plus est, le numérique n’est-il pas la voix de l’avenir pour assurer la transition écologique, optimisant nos processus pour les rendre plus économes et moins polluants, via ce qu’il est convenu d’appeler la «double transition», numérique et écologique ?
Retour à la réalité d’aujourd’hui…
Le numérique pollue. Beaucoup. Beaucoup trop.
Des chiffres ? Des lettres plutôt pour commencer, les (extraits de) titres d’ouvrages grand public récents parus sur la question sont éloquents : «L’enfer du numérique» (Pitron, 2021), «un désastre écologique» (Flipo, 2021), «On va droit dans le mur ?» (Julia, 2022). Malgré leurs titres tapageurs, ces ouvrages sont tout à fait documentés, et étayés par des études sérieuses réalisées par exemple par l’ADEME (l’Agence de la transition écologique en France) ou le Shift Project (think tank œuvrant pour une société décarbonée, composé de scientifiques). On cite souvent le chiffre de 4 % des émissions de gaz à effet de serre, chiffre qui peut sembler modeste, mais qui est deux fois plus élevé que celui de l’aviation civile ! Mais au-delà des chiffres, c’est avant tout la destruction et la contamination de larges zones géographiques, liées notamment aux activités minières et au traitement (illégal) des déchets électroniques, la monopolisation de l’énergie par les centres de données (le «cloud»), l’épuisement progressif des ressources, etc. Sans oublier les conditions sanitaires et sociales inimaginables grâce auxquelles nos chers appareils sont produits (mines en Centre Afrique, usines Foxconn en Chine, déchèteries au Ghana, etc.).
Vous n’étiez pas au courant ?
C’est normal. Comme il est tout à fait normal que vous oubliiez tout cela peu de temps après la lecture de ces lignes. Non seulement nous sommes submergés par des publicités vantant les mérites de dispositifs numériques légers et porteurs de bien-être, mais aussi, et surtout, un message, explicite ou tacite, sous-tend notre activité citoyenne et professionnelle : le numérique est et sera l’avenir, il est porteur de progrès et d’innovation ; penser autrement, c’est penser de manière réactionnaire, dans toute la signification péjorative du terme.
Que faire ?
Je n’aborderai ici que la sphère professionnelle liée au e-learning, sa conception et son usage, laissant notamment de côté les sphères privées et politiques.
Il n’y a pas de réponse immédiate et facile à la question : les questions écologiques sont complexes, les réponses à apporter aussi. Mais je peux aiguiller vers deux attitudes importantes à adopter :
- En matière de conception, penser à adopter une approche de sobriété et d’éco-conception. Cela commence par compresser ses documents et vidéos (réduire), puis se poser la question de savoir si on a vraiment besoin de ces mêmes vidéos (renoncer), se méfier de solutions logicielles complexes qui nécessitent de puissantes machines pour être utilisées, remettre en cause certaines vieilles habitudes bien ancrées dans les pratiques (utiliser PowerPoint pour faire un cours, stocker les ressources sur des serveurs distants, etc.).
- Ne pas céder aux «dernières technologies innovantes», ce sont en général les plus polluantes. Ce n’est pas parce qu’une technologie est nouvelle qu’elle doit nécessairement être adoptée. Rappelons ici un principe de base de conception pédagogique : c’est le besoin qui prime, toute technologie n’est pas en elle-même meilleure qu’une autre approche. On le savait déjà, mais maintenant que l’on connaît les conséquences environnementales, cette sagesse devient d’autant plus essentielle.
Au final, adopter la sobriété numérique c’est bien plus que «faire attention» à ses comportements de consommation. C’est questionner les usages à l’aune de la crise écologique et donc repenser la notion même d’innovation. En effet, cette dernière est, depuis plusieurs décennies déjà, auréolée d’un prestige inconditionnel, et immanquablement associée aux technologies numériques. Il conviendrait d’innover moins et d’innover mieux. Goûter la saine satisfaction d’un usage parcimonieux mais bénéfique du numérique.
Pour aller plus loin...
Des références :
Aggeri, F. (2023). L’Innovation, mais pour quoi faire ? Essai sur un mythe économique, social et managérial. Seuil.
Ferreboeuf, H., & The Shift Project. (2018). LEAN ICT- POUR UNE SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE. https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf
Flipo, F. (2021). La numérisation du monde. Un désastre écologique. Éditions L’échappée.
Julia, L. (2022). On va droit dans le mur ? Pour sauver la planète, il faut un projet de société et une ambition de civilisation. Editions First.
Pitron, G. (2021). L’enfer du numérique : Voyage au bout d’un like. Éditions Les Liens qui libèrent.
Une formation :
La sobriété numérique, le 12 juin 2024.